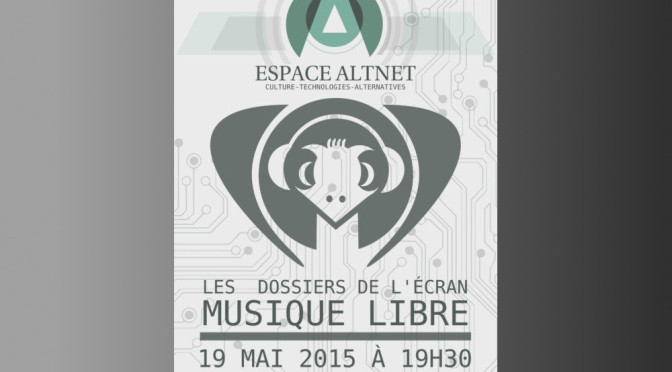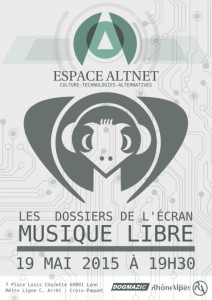Quoi de neuf ?
Depuis bientôt un an, de nombreux nouveaux inscrits ont rejoint LinuxMAO. Alors pour se tenir au courant des nouvelles arrivées (et peut-être trouver une personne avisée pas loin de chez soi), n’oubliez pas d’aller lire les présentations des nouveaux arrivants : forum des présentation !
Musique sur linuxmao
Parce que les musiciens ont besoin de partager, de se retrouver autour des créations des uns et des autres, un forum existe pour ces rencontres ! Il est ouvert à vous, créateurs, mais aussi à vous, auditeurs curieux qui souhaitez découvrir d’autres climats sonores : forum des créations.
Rien de plus stimulant qu’une composition avec contraintes ! C’est le principe des joutes musicales. La joute numéro 10 (au thème galactique et inspirant) vient de se conclure. Restez branché pour participer à la prochaine !
Pendant son sommeil, l’édito a laissé notre liste de morceaux s’enrichir de nombreuses productions, qu’il serait trop long d’énumérer ici. Toutes les infos sont présentes sur le forum des créations et la page des joutes musicales.
Musique libre en dehors de linuxmao
Musica Libre , c’est l’émission mensuelle de Prun’ sur les musiques libres, elle est diffusée tous les 2ème mardi de chaque mois de 12h à 13h.
, c’est l’émission mensuelle de Prun’ sur les musiques libres, elle est diffusée tous les 2ème mardi de chaque mois de 12h à 13h.
Le podcast de la dernière émission ici, elle est enregistrée et présentée avec des logiciels libres par un membre de LinuxMao, napz.
Album : ALban Lepsy – Musique de films chez les copains de Dogmazic.
Nouvelles du monde
LAC 2017
La « Linux Audio Conférence » est le rendez-vous annuel qui réunit les principaux acteurs internationaux (utilisateurs, développeurs, chercheurs) du logiciel libre, autour du son et de la musique.
Elle aura lieu cette année à St Étienne (42), pour la première fois en France, du 18 au 21 mai.
Au programme (non précisé à cette heure), des conférences et des concerts, gratuits de surcroît.
Cerise sur le gâteau, Paul Davis sera un invité de la LAC et introduira la conférence.
Plus d’infos ici .
.
Matériel
Un nouveau synthétiseur, le Nozoïd OCS-2, est sorti : basé sur un arduino, ce synthétiseur numérique, semi-modulaire, est modifiable grâce à son code open-source ![]() , plus d’infos allez voir ici
, plus d’infos allez voir ici .
.
Nouveautés sur linuxmao
Le mois de Janvier 2017 a vu le record historique de fréquentation dépassé pour atteindre 31392 visiteurs uniques. C’est la première fois depuis le début du site fin 2005 que la barre des 30000 est dépassée. Le précédent « record » était de 29584 en Novembre 2016.
Autre dépassement, le mois de Février 2017 a vu passer la 6000ième inscription d’un compte sur linuxmao.org . Concernant les inscriptions, nous sommes sur une moyenne d’un tout petit peu moins d’une nouvelle inscription par jour sur les 2 derniers mois (pas regardé avant, mais ça doit être du même tonneau à vu de nez). Tout le monde est encouragé à accueillir les nouveaux arrivants dans le forum de présentation, ce qui permet de commencer à tisser des liens entre nous et d’éviter ainsi la déshumanisation inhérente à l’outil informatique.
La documentation s’est enrichie de nombreuses pages. Il s’agit principalement de sujets concernant des logiciels (24 nouvelles pages pour les mois de janvier et février 2017) ou des matériels (5 nouvelles pages dans pour les mois de janvier et février 2017) qui ne figuraient pas encore dans la documentation.
Concernant l’administration du site, notons que :
- allany devient admin général. Voir ce fil de discussion,
- sub26nico est entré dans l’équipe en tant qu’admin forum.
- RomainCan est entré dans l’équipe en tant que coordinateur de l’éditorial.
Coté logiciel sur LinuxMAO
- Antony87 a mis à jour en février son logiciel d’échantillonnage pensé pour la gestion d’une conduite de théâtre et nommé « EasyConduite« .
- jean-emmanuel continue à développer activement son logiciel « Open Stage Control« .
- pmu33 continue de travailler sur l’ensemble d’outils en CLI pour faciliter la création de banque de son au format SFZ nommé « zictoolspm« . Voir ce fil de discussion et celui-là aussi.
- Shangri-l a sorti en février une nouvelle mouture de son logiciel de gestion de contenu (CMS
 ) dédié aux artistes/labels nommé « CreRo ». Voir ce fil de discussion.
) dédié aux artistes/labels nommé « CreRo ». Voir ce fil de discussion. - onirom a dévoilé une première version de « Fragment », un logiciel de synthèse virtuelle en ligne. Voir ce fil de discussion.
- mrkebab a sorti une nouvelle version de sa distribution io.gnu.linux en février.
- olinuxx a continué à bosser sur LibraZiK (mises à jour, nouveaux logiciels, nouvelles documentation,…). Voir le blogue de LibraZiK
 pour de plus amples informations.
pour de plus amples informations.
Pour voir ce qui se passe du côté du développement de ce qui touche à l’audio sous linux, rendez-vous dans la section de forum : 7 – Développer/Traduire/Documenter/Annoncer une application‘.
Côté logiciel en dehors de linuxmao
Grâce aux annonces de nouvelle version logiciel faites par : balthazar, pierrotlo, jean-emmanuel, sub26nico, olinuxx, victor, tenryu, et Antony87, voici une liste de logiciels mis à jour lors des derniers mois :
- en décembre 2016 :
- Spectrum3D en version 2.7.1
- TuxGuitar en version 1.4
- Yoshimi en version 1.5.0
- Nootka en version 1.4.0
- en janvier 2017 :
- Apodio en version 11
- lsp-plugins en version 1.0.20
- Drumgizmo en version 0.9.12
- Giada en version 0.13.2
- en février 2017 :
- easyconduite en version 1.2 : reprise du développement de la part de Antony87.
- Qtractor en version 0.8.1
- ardour en version 5.8
- zam-plugins en version 3.8 qui apporte une réécriture majeure du moteur du zam-tube, ainsi que 2 nouveaux greffons
- gxplugins.lv2 (nouveau) en version 0.2 : une nouvelle ribambelle de greffons LV2, principalement des simulations de pédales d’effets et de têtes d’ampli pour guitare
- io.GNU.Linux en version 2017.01 : développé par MrKebab
- en mars 2017
- Harrison Mixbus en version 4
- Audacity en version 2.1.3
- Open Stage Control en version 0.17.1 : développement toujours très actif de la part de jean-emmanuel
- zictoolspm en version 1.0.5
Tout utilisateur peut aider à la remontée des informations concernant les nouvelles versions en lisant le paragraphe Mettre à jour une version d’un logiciel. Allez, viens nous aider ici !
Post scriptum
Merci à Sasaki, allany, olinuxx, sub26nico et RomainCan pour l’écriture de cet édito, et on se retrouve le mois prochain pour une revue de l’actualité de mars !



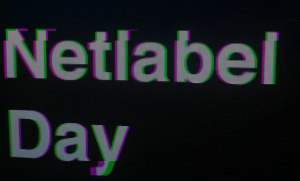
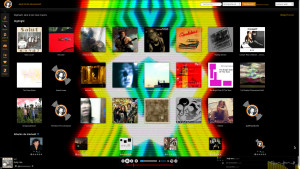

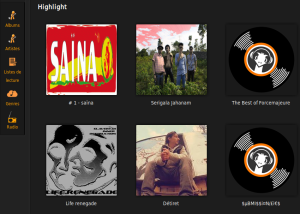
 (le
(le  qui sous-tend le site linuxmao.org)… et pas mal d’autres choses à lire plus en détail ci-dessous.
qui sous-tend le site linuxmao.org)… et pas mal d’autres choses à lire plus en détail ci-dessous.